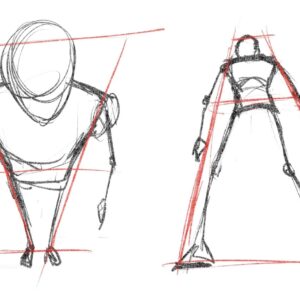Au jour un de la nouvelle administration américaine, l’Union européenne apparait diminuée pour résister à la charge commerciale annoncée par le président Trump. Mais l’interdépendance entre les deux alliés historiques est plus profondément inscrite que ce que laisse croire le nouveau locataire de la Maison Blanche, qui pourrait bien avoir eu tord d’aiguiser son appétit sur le vieux continent.
Une guerre commerciale in fine défavorable aux américains ?
Le reproche initial formulé par Trump à destination des européens tient sur une seule crispation : la trop faible contribution de l’Union européenne aux programmes de défense militaire de l’OTAN essentiellement soutenus par les États-Unis. L’homme d’affaires et président réélu a réclamé des gouvernements qu’ils rehaussent leur budget militaire au dessus de la barre des 5% de leur PIB, sans quoi il envisagerait de couper les vannes de l’OTAN. Fort de sa position de négociation face à une commission européenne diminuée, le président républicain entend profiter de l’absence de consensus au sein du bloc allié pour revendre du matériel militaire américain et conclure des contrats prospères à Bruxelles. Dans les faits, le retour au pouvoir de la politique MAGA, qui vise à prioriser les intérêts de l’Oncle Sam, pourrait coûter cher au contribuable des Fifty States. D’abord parce qu’une augmentation des taxes américaines sur les marchandises européennes se répercuterait directement sur le prix d’achat des consommateurs états-uniens, alors même que Trump a promis de réduire l’inflation qui touche déjà les foyers les plus modestes et pauvres du pays. Ces contritions monétaires imposées par Washington pour sanctionner les européens pourrait agir comme un boomerang, fragilisant l’équilibre des balances commerciales pour les deux parties.
De plus, si en France la haute administration et les grands postes économiques sont fusionnés, il en va différemment de la politique américaine qui s’appuie sur trois pôles de pouvoir bien distincts : la sphère économique, la présidence et le pôle stratégique, domaine partagé entre le Pentagone et le Congrès chargé des politiques publiques à long terme. Un rôle que les sénateurs prennent très à cœur et qui a conduit par le passé le pouvoir législatif américain à soutenir des procédures de comparution, voire de destitution. Les influentes commissions qui nichent la Chambre des Représentants et le Sénat vont donc suivre de près les orientations stratégiques décidées par Trump, notamment à l’égard de son allié européen. En cas d’incompatibilité avec les objectifs fixés par la législature américaine, les décisions du président réélu pourraient susciter l’ardeur des contre-pouvoirs à Washington.
La question du conflit ukrainien suspendue
Ce calcul en rationalité se présentera également aux nouvelles équipes de la Maison Blanche s’agissant du conflit russo-ukrainien. La question pourrait même muer en équation pour Trump, qui promettait initialement de mettre fin à la guerre dès son arrivée, et qui pourrait finalement décider de jouer la montre en retardant les négociations diplomatiques avec le Kremlin. Car la cessation du conflit à l’Est de l’Europe mettrait un coup d’arrêt aux exportations d’armes américaines. Or, Donald Trump pourrait trouver son avantage en promettant des discussions rapides, tout en maintenant la vente de contrats d’armement aux Pays-Bas ou à la Pologne qui craignent la proximité directe avec la Russie. D’autant que le nouvel occupant de la Maison Blanche semble vouloir écarter les européens des négociations sur la fin du conflit en dialoguant en tête à tête avec Poutine, ce qui aurait pour effet de geler plus encore la relation avec les membres de l’alliance transatlantique. Ainsi, l’opération qui ne devait être qu’une formalité s’apparente comme un exercice aussi délicat que décisif pour la nouvelle administration américaine, et pour l’avenir de sa relation avec l’Europe.
D’autant que la machine européenne aura à dealer avec l’opposition ténue du néo-fonctionnaire de la gouvernance économique américaine Elon Musk, désormais mu en « combattant politique » anti-européen depuis que la Commission a entrepris d’imposer son Digital Act aux plateformes numériques, parmi lesquelles le réseau social « X » qu’il dirige.
Une dépendance réciproque

Pour les européens comme pour les citoyens états-uniens, tout reposera au final sur la finesse de la taxation imposée par l’administration américaine, qui se filera au compte-goutte sur certains types de produits et dans certains proportions. Pour sûr, depuis son retour aux manettes, Trump multiplie les menaces de taxation (20% sur le Canada, 10% sur la France, 50% sur le Mexique), sans se hâter à la décision. Les entreprises outre-Atlantique et européennes, comme les dirigeants politiques, sont donc priées de patienter.
Dès lors, la politique d’austérité promise par le 47ème président des États-Unis à l’égard de ses alliés pourrait ne jamais advenir. Car si l’Europe est aujourd’hui excédentaire de 150 milliards dans sa balance commerciale avec les États-Unis – l’Union européenne exportant annuellement davantage que les américains -, ces derniers peuvent se targuer d’un excédent budgétaire de plus de 100 milliards sur la vente de services par rapport à Bruxelles. In fine, le solde des deux est donc très faiblement déficitaire à la nouvelle administration de la Maison Blanche. Assez pour s’en prendre à un allié historique ? D’autant que “la situation géopolitique est largement à l’avantage des américains en ayant les européens sous leur aile, prédit le professeur Christian Saint Étienne, ils y gagnent en influence géostratégique”. Dans l’équilibre des relations internationales, “l’Europe, c’est aussi 27 voix qui votent avec les US à l’ONU. Si certains partenaires européens se mettent à voter avec la Chine ou la Russie, notamment à l’OMC, alors le Sud global deviendra juste le conflit du monde contre les États-Unis” prédit-il. Une hypothèse qui présage les conséquences instables d’une querelle diplomatique et commerciale entre deux blocs historiquement dépendants, surtout à cet instant de l’histoire du monde contemporain qui voit se dégrader la fracture Nord-Sud.
Au sein de l’Union, des intérêts divergents pour un échec commun

Parmi les failles au consensus européen, l’affaiblissement des relations franco-allemandes. D’abord et avant tout parce que les deux partenaires sont individuellement atteints : la France couve une crise politique majeure après la nomination de quatre premiers ministres en moins d’un an, et l’Allemagne a vu sa coalition exploser, accélérant la chute du chancelier Olaf Scholz. Le retour de Donald Trump aux affaires impose donc un défi de taille pour des alliés qui apparaissent dispersés, particulièrement dans certains secteurs comme l’automobile, l’intelligence artificielle ou les politiques migratoires. L’Allemagne, comme l’Italie ou la Hongrie, pourrait compromettre le sort de l’Union en bloquant l’adoption de certaines mesures de contorsions prises à l’encontre du gouvernement américain en cas de droits de douane défavorables.
Car pour voter ces sanctions et impulser les grandes orientations, il sera nécessaire de réunir un consensus entre les différents partenaires. Or pour l’heure, les intérêts divergents risquent de scinder l’Europe, au moment où Donald Tusk, premier ministre polonais, et Emmanuel Macron ont tous deux appelé à la construction d’un « front de défense unitaire » pour contrer le projet américain d’affaiblissement de l’Union européenne.
D’autant que ce malheur européen semble constituer une porte d’entrée idéale de la stratégie offensive américaine qui compte sur l’apparente désunion des dirigeants du vieux continent pour étendre sa position et affaiblir l’Europe. “Ce serait bien d’éviter la guerre commerciale, prévient Arnaud Aymé, spécialiste des transports pour un cabinet de conseil français, nous avons pour l’heure une dépendance aux technologies américaines pour prospérer (…), particulièrement sur les véhicules électriques.” ” Ainsi, le développement d’une ligne de production de pièces électroniques et informatiques européenne revêt désormais un intérêt essentiel pour garantir l’indépendance et l’autonomie futures de l’Union, au moment où elle tente de promouvoir des politiques publiques décarbonées. Dans le scénario d’un rapport de force installé entre US et UE, Trump pourrait aller jusqu’à déclarer un embargo sur les puces produites par le groupe américain NVIDIA, qui alimente très largement les constructeurs européens comme Mercedes, Volvo, Jaguar, BYD, Tesla, Land Rover… Un scénario qui doit inviter les alliés à repenser une stratégie commune face aux élans néo-impérialistes de la nouvelle administration Trump.
Une réponse coordonnée de l’Europe : rempart à l’appétit américain ?
En attendant le choc, les européens semble patienter en opposant la voie diplomatique. Plusieurs dirigeants membres de l’OTAN comptent “répondre” aux menaces américaines en mobilisant des recours devant l’Organisation Mondiale du Commerce, laquelle permet de contester l’instauration abusive de droits de douane. Néanmoins, Trump a annoncé vouloir débrancher cette autorité de régulation internationale. Les tentatives de pression exercées par les organisations historiques pourraient révéler infructueuses et permettraient au leader américain d’affirmer sa supériorité face à un droit international impuissant. Au premier jour de son mandat, ce dernier a en effet signé par décret la sortie des États-Unis de l’Organisation Mondiale de la Santé. Un signe avant-coureur de ce qui pourrait suivre en matière économique ? Le consortium politique devra toutefois tenter de convaincre l’ancien homme d’affaires de l’intérêt majeur de maintenir une relation stable avec ses partenaires européens. Autrement, plusieurs puissances otaniennes pourraient n’avoir d’autre choix que de faire appel au marché chinois pour se fournir en composants électroniques et en matières premières.
La stratégie de Trump, qui visait initialement à faire contribuer davantage le bloc européen, pourrait in fine conduire certains alliés dans les bras de Pékin. Face à son premier rival commercial et militaire, les États-Unis perdraient beaucoup à se distancer du marché européen, lequel représente toujours 18% du PIB mondial. Si gain il y’avait pour l’administration américaine, il ne serait donc que de court terme. Sur le plan géostratégique, la fin de la relation spéciale qui lie le bloc occidental renverrait un signal de faiblesse au reste du monde, en premier lieu pour Washington.

Dans le cas où elles apparaîtraient unies, notamment autour de mesures de rétorsions sur les GAFAM et les produits américains importés, les nations continentales pourrait rééquilibrer le rapport de force. De telles mesures semblent possibles et impliquent un sursaut dans la décision européenne, « une prise de conscience urgente et immédiate » pour faire face, selon Dominique de Villepin, aux superpuissances américaines et chinoises. L’Europe, qui ne se bat pas pour la domination mondiale, doit donc s’efforcer de comprendre que ce duel au sommet pourrait bientôt la concerner. “Nous sommes la grosse dinde bien grasse sur la table entre les deux grands loups” traduit familièrement Christian Saint-Étienne.
En guise de solution, tachons de nous souvenir des enseignements tirés des contes de Perrault ? Si face au loup, le Petit Chaperon rouge a multiplié les stratégies, laquelle adopter pour peser dans la balance ? À terme, le rapport de force imposé par Trump met l’Union européenne face à une seule question : faut-il entrer en conflit avec la nouvelle administration américaine, ou faut-il tenter de l’amadouer ? Car face à un appétit aiguisé, les solutions sont maigres. Ou il faut le rassasier, en sacrifiant une part de soi, ou il faut en détourner l’attention vers d’autres sources de satiété.