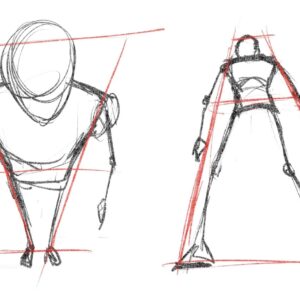À l’occasion d’une plainte déposée par l’Afrique du Sud en décembre accusant Israël de comportement génocidaire, les juges de la Cour internationale de Justice examinaient dès le 11 janvier les arguments des deux parties. En parallèle de la grande confusion médiatique qui s’agite autour du conflit israélo-palestinien, le Droit international, lui, suit son cours et actionne ses engrenages dans le processus de paix.

© Remko DE WAAL pour ANP/AFP
Après cent jours de guerre à Gaza, le bilan humain face à « l’intention » d’Israël
Accusée par l’Afrique du Sud de « comportement génocidaire à l’égard du peuple gazaoui », l’État israélien devait répondre de ses crimes supposés devant la Cour internationale dans une audience pour l’Histoire. Cent jours après les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas, lesquelles ont causé la mort de 1.140 personnes (AFP) et la capture de plusieurs dizaines d’otages, les instances internationales actionnent leurs leviers juridiques. Depuis cette date, le premier Ministre du gouvernement d’Israël Benjamin Netanyahu s’est attaché à répliquer avec une violence inédite dans l’histoire du conflit israélo-palestinien. Mais loin du tourbillon médiatique, le premier jour d’audience devait donc permettre ce 11 janvier d’exprimer les prétentions de chacune des parties dans une enceinte solennelle, éloignée du feu de la guerre. En ce sens, l’avocat britannique Vaughan Lowe, orateur pour l’Afrique du Sud, a tenté de démontrer le « caractère génocidaire » des répressions d’Israël, qui ne sont « pas question d’échelle mais d’intention ». Selon lui, le point de passage du drame au génocide ne s’établit donc pas via le comptage du nombre de morts, mais par l’intention des auteurs, responsables politiques et militaires.

À gauche, l’ambassadeur de la République d’Afrique du Sud aux Pays-Bas, Vusimuzi Madonsela. Au second plan, les représentants de la défense israélienne. ©Thilo Schmuelgen pour Reuters
Dès lors, Israël devait faire face à un bilan humain très lourd, jugé « disproportionné » par les avocats prétoriens (de la capitale administrative de l’Afrique du Sud, Pretoria) qui initiaient la plainte. À ce jour, plus de 23.000 palestiniens auraient été tué, « en majorité des femmes, des adolescents et des enfants » selon les chiffres du ministère de la Santé de la bande de Gaza, administré par le Hamas, dont la méthode de collecte d’informations jugée crédible par l’ONU dénombre également plus de 50.000 blessés civils et militaires. À l’échelle internationale, l’ampleur de la vague de violence qui s’est abattu sur Gaza a imprimé l’image des cadavres empoussiérés dans les esprits occidentaux, prenant pour témoin le monde entier via des captures vidéos enregistrées et diffusées par la population locale et les journalistes présents sur zone, devenue un « cimetière pour enfants » selon le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, .
Dans ce climat politico-médiatique ulcéré, les formations politiques cherchent à trouver le juste équilibre. Si certaines restent taiseuses sur le sujet, d’autres tentent de replacer le débat dans une perspective historique. C’est en tout cas l’idée qu’a défendu la sénatrice écologiste Raymonde Poncet Monge lors de la dernière séance de questions au gouvernement au Sénat : « Le taux de mortalité quotidien à Gaza est supérieur à celui de n’importe quel conflit armé du 21ème siècle, sans compter les personnes ensevelies, blessées et les 85% de la population déplacée » alertait-elle ce mercredi à l’occasion d’une question adressée à Stéphane Séjourné, récemment investi ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Ce dernier a alors répondu en appelant à « ne pas franchir un seuil moral en accusant un État juif de génocide », regrettant que soit exploitée à des fins politiques une telle notion. Dans quelques semaines, à l’occasion du verdict, la France devra en tout cas trancher. Elle pourra alors choisir de relayer, ou non, la décision de la Cour pénale internationale et de soutenir les opérations de contre-mesures qui pourraient être prises à l’égard d’Israël.
Pour Tel Aviv, « ni destruction, ni génocide », mais une réponse à un élément déclencheur
En réponse, l’État d’Israël s’estime « accusé de génocide au moment même où il combat le génocide », selon les termes du premier Ministre Nétanyahou. Pour Tal Becker, un des principaux avocats d’Israël devant la Cour, « l’intégralité de l’argumentation sud-africaine repose sur une description délibérément organisée, décontextualisée et manipulatrice de la réalité des hostilités actuelles ». La défense a ainsi martelé « qu’un examen attentif de la politique et des décisions officielles depuis le 7 octobre ne révélerait aucune intention génocidaire » de la part des responsables israéliens. Pour l’État hébreu, les mesures provisoires invoquées par l’Afrique du Sud, comme l’arrêt de l’offensive militaire, devraient donc être rejetées, car elles seraient profitables au Hamas. Sur ces mesures, la CIJ se prononcera dans quelques semaines. Mais la procédure de fond, elle, pourrait prendre des mois voire des années avant qu’un jugement soit prononcé, établissant, ou non, la commission d’un génocide contre le peuple gazaoui.

Réclamée par une majorité de nations devant l’ONU, la condamnation internationale à l’encontre d’Israël a finalement été appuyée par un large consensus d’états. Les hésitations de certains pays à appeler à un cessez-le-feu sont durables et pour certaines fixées, à l’instar de la France qui s’est finalement opposée aux exactions des forces de Tsahal (armées de l’État d’Israël) dans la bande de Gaza. Dans une conférence de presse tenue le samedi 13 janvier à Tel Aviv, la réponse du Premier ministre hébreu dirigée à l’attention de la communauté internationale a été particulièrement explicite : “personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l’Axe du mal“. L’idée qu’une paix durable puisse être initiée dans un futur proche semble donc compromise.




- Sources : Le Monde, le Courrier international, Euronews, avocatsparis.org